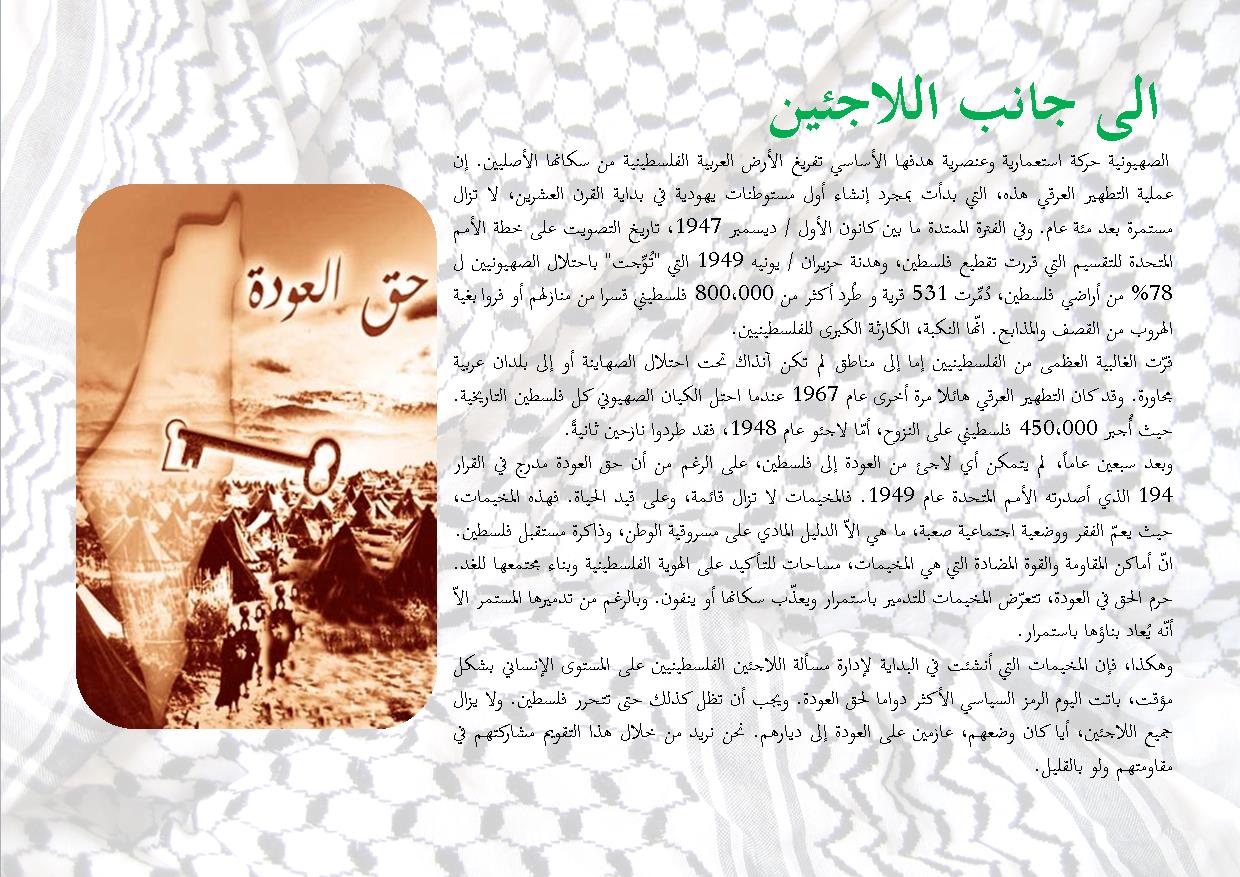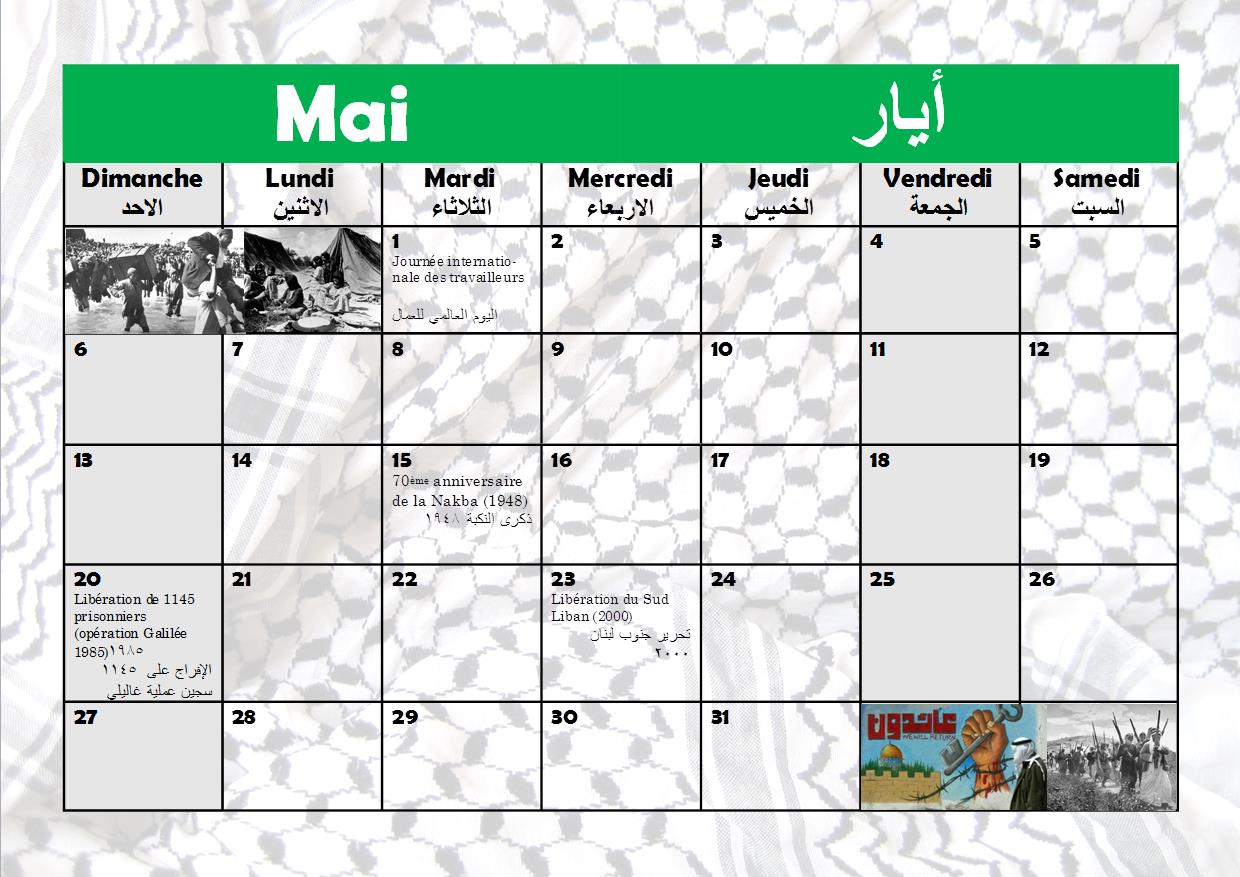Interview de Ihsan Ataya (Abu Hussam), représentant du Mouvement du Jihad Islamique en Palestine au Liban.
Né à la fin des années 1970, ce mouvement a su lier nationalisme, religion et révolution. Il puise dans les principes islamiques, tout en s’inscrivant dans une pédagogie, révolutionnaire, du dialogue et de l’unité entre les différentes composantes religieuses et laïques du projet de libération. Il enracine sa stratégie dans la conscientisation des masses à qui il incombe de libérer la terre de Palestine de l’emprise sioniste et impérialiste. Le mouvement du Djihad islamique en Palestine contient en germe la solution future à la division permanente du mouvement national palestinien en de multiples factions qui s’opposent sur la stratégie à tenir face à l’ennemi sioniste. En ce sens et objectivement, le mouvement du Djihad islamique est un parti révolutionnaire. Son existence est la réalisation pratique et en mouvement de la conscience palestinienne et arabe. Elle peut se résumer à ce slogan : Islam, unité et résistance.
Comité Action Palestine
—————————————————————————————————————————————–
Propos recueillis le 22 septembre 2017, à Beyrouth par T.E.M.
Quelle est la spécificité du Jihad islamique et sa place dans le mouvement national palestinien ?
Ihsan Ataya : C’est une question fondamentale. Le Jihad islamique est un mouvement de résistance dont l’objectif est la libération de l’ensemble de la Palestine ; pas la moindre parcelle de terre ne peut être abandonnée à l’ennemi sioniste. La présence israélienne en Palestine n’est que provisoire. Fondée sur l’expulsion du peuple palestinien, Israël n’a pas d’assise stable. Le Jihad islamique n’est pas le premier mouvement de libération armé en Palestine, d’autres l’ont précédé. La spécificité de ce mouvement est qu’il est apparu à un moment précis où il était nécessaire de lier la résistance à l’Islam. Il existait, d’un côté, des mouvements de libération nationale sans référence islamique, et de l’autre, des musulmans qui n’adoptaient pas la résistance en tant que telle. Le Jihad a fait le lien.
Le projet sioniste consiste à s’emparer de la Palestine et anéantir son existence jusque dans les esprits. Il est fondé sur l’expulsion du peuple palestinien, et in fine, il s’agit de rayer la Palestine de la carte. Ce projet se poursuit aujourd’hui avec la volonté d’expulser aussi les Palestiniens de 48 vers Gaza ou en dehors des frontières de la Palestine. L’objectif est de fonder un Etat juif, au sens religieux du terme. Depuis quelques temps, il y a une nouvelle vague d’expulsion des Palestiniens comme au Liban et en Syrie, où des réfugiés sont contraints de partir. Cette situation dans les camps de réfugiés met en péril la cause palestinienne.
Les accords d’Oslo représentent une phase importante du projet sioniste car c’est une nouvelle étape dans la colonisation et le pillage des terres. C’est une phase défavorable aux Palestiniens. Le Jihad est un mouvement armé qui veut la libération de toute la Palestine et qui essaye de maintenir la cause palestinienne et la flamme de la résistance à l’échelle du monde arabe et musulman, et de faire adopter par la solidarité internationale (arabe, musulman ou non) une vision unifiée du combat palestinien.
Quelle analyse faites-vous du mouvement national palestinien ?
Ihsan Ataya : Le fait récent le plus important est la question de la réconciliation entre le Hamas et le Fatah, dans laquelle l’Egypte joue un rôle historique positif. Si le Jihad soutient toutes les formes de réconciliation entre les parties palestiniennes, il faut, néanmoins, distinguer les forces politiques qui s’opposent aux négociations avec Israël, et celles qui militent pour un règlement pacifique, en lien avec l’Autorité palestinienne. Le Jihad s’associe à toutes les forces qui œuvrent dans le sens de la libération de la Palestine. En revanche, il s’oppose politiquement à tous les mouvements et les projets favorables à un règlement négocié, car il est illusoire de croire qu’Israël cède quoi que ce soit. L’Autorité palestinienne est un produit de l’occupation qui exerce son contrôle sur des territoires occupés. Le Jihad mène une résistance armée, mais il accomplit aussi un travail idéologique, d’information et de conscientisation des nouvelles générations. C’est une résistance globale. De ce point de vue, le mouvement entretient des relations avec toutes les organisations présentes sur le terrain pour régler des problèmes de la vie quotidienne, y compris avec certaines organisations dont nous ne partageons pas le projet politique. Le Jihad Islamique approuve et soutient toutes les actions de résistance à Israël, d’où qu’elles viennent. S’agissant des organisations qui ne sont pas sur ces bases, le Djihad maintient des relations et essaie de les convaincre.
Que pensez-vous du rapport de force actuel ? La situation est-elle favorable à la résistance ?
Ihsan Ataya : Que s’est-il passé lors de la confrontation autour de la Mosquée al-Aqsa, il y a quelques mois ? Le Palestinien, même sans armes, sans soutien, a réussi à imposer aux Israéliens le retrait des portiques de sécurité (caméras et barrières). Le peuple à mains nues a réussi à faire reculer l’entité sioniste. C’est une philosophie particulière de la résistance palestinienne. Tant qu’il n’y a pas de complot contre lui, le Palestinien peut chasser les Israéliens de sa terre. Sa volonté et sa foi sont suffisantes.
La nécessité du soutien arabe et musulman à la résistance du peuple palestinien contrebalancerait l’alliance internationale qui a fondé et soutenu le sionisme en Palestine. Et nous les Palestiniens nous souhaitons être le fer de lance de la lutte contre Israël. Dans ce cadre, nous représentons le vrai contre le faux, dont Israël est l’incarnation. La Résistance, le Jihad Islamique et tout autre mouvement font partie, est à la pointe de la lutte du vrai contre le faux.
C’est un grand honneur pour nous que la Palestine soit dans une position d’avant-garde dans la lutte contre le sionisme. Qu’il existe une asymétrie des rapports de force n’est pas un problème en soi. Ici on dit que l’enfant n’est pas capable de ranger les ustensiles de la cuisine, mais il peut tout mettre par terre en un seul geste. L’ennemi est plus fort militairement, mais la volonté et la persévérance nous permettent d’imposer à l’ennemi de nouvelles équations dans le rapport de force.
Que représente al-Aqsa pour la résistance palestinienne ?
Ihsan Ataya : La Mosquée al-Aqsa, comme la Palestine, constitue une partie de la doctrine islamique. C’est un symbole religieux qui rassemble toutes les forces de la résistance palestinienne, au-delà de leurs confessions. En Palestine, plusieurs religions coexistent, contrairement à de nombreux pays arabes. Les Chrétiens ont défendu la Mosquée al-Aqsa, qui devient ainsi un symbole religieux fédérateur. En ce sens, il prend un caractère politique puisqu’il mobilise toutes les communautés religieuses dans le projet de libération nationale. La Mosquée al-Aqsa incarne également l’unité de la société : quelles que soient leurs appartenances sociales, les Palestiniens y vont prier.
Sur le plan politique, la mobilisation pour la mosquée al-Aqsa a fait reculer les Palestiniens qui souhaitent un règlement négocié au risque d’abandonner les constantes du mouvement national. La mosquée Al-Aqsa est très chargée symboliquement et, à ce titre, elle est au centre des revendications palestiniennes. Elle est partie intégrante de la cause nationale. Les évènements récents autour de la mosquée ont eu une implication jusqu’en Jordanie (le roi est le protecteur des lieux saints), qui a demandé le retrait des forces israéliennes. Le fait de fonder un Etat juif et de diviser la Mosquée al-Aqsa donne à ce conflit une nature religieuse. Or, la communauté internationale redoute que le conflit prenne une tournure religieuse. Pour le Jihad Islamique, il n’y a pas de différence entre le politique et le religieux. Dans les faits, ces deux registres sont mêlés. Les Palestiniens ont tenu bon et ont réussi à imposer aux pays arabes un positionnement plus ferme vis-à-vis d’Israël. Sans cette résistance, les pays arabes auraient accepté la situation telle qu’Israël voulait l’imposer.
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par la notion de complot ?
Ihsan Ataya : Le complot a deux aspects indissociables. Le premier est de détruire et déstabiliser l’axe de résistance (Iran, Syrie, Liban, la Palestine, Gaza). L’administration américaine et l’Occident en général soutiennent le projet sioniste et tentent de briser la résistance. C’est normal, c’est dans la nature de l’Occident. Les Etats-Unis ont une stratégie économique de pillage et de division du monde arabe. Même si c’est dans notre région qu’on en voit les effets les plus dévastateurs, les Américains exploitent et pillent à l’échelle internationale. Face à cela, la résistance se développe. Ainsi à Gaza, la résistance est parvenue à conserver sa puissance, sa force, ses armes contre les sionistes. Elle a réussi à repousser l’ennemi à plusieurs reprises.
Le deuxième aspect du complot est la question de la suppression du droit au retour pour les réfugiés palestiniens. Actuellement les USA, l’Egypte, l’Arabie saoudite et Israël cherchent un accord pour supprimer le droit au retour. Dans les faits, cela se traduit par la destruction des camps et la dispersion des réfugiés palestiniens. Supprimer le droit au retour reviendrait à anéantir la cause palestinienne.
Quelles sont les actions que le mouvement mène pour contrecarrer cette entreprise de destruction du droit au retour ?
Ihsan Ataya : Pour libérer la terre de Palestine, il faut travailler sur la conscience dans les camps et parmi les Palestiniens exilés partout dans le monde contre la suppression du droit au retour et maintenir vivant l’objectif de libération. L’enjeu crucial est de lutter contre le projet sioniste de destruction de la conscience palestinienne, en préservant le droit au retour et le lien entre les réfugiés et leur terre. En parallèle de la question de la conscience, il y a le travail politique, qui consiste, en relation avec les organisations dans chaque pays, à développer le thème du droit au retour et à lutter contre les appels à l’émigration massive des Palestiniens. Pour cette raison, il faut faire pression pour améliorer les conditions économiques des Palestiniens dans les camps pour qu’ils y demeurent jusqu’à l’application de leur droit au retour. Par exemple au Liban, de nombreux services ne sont plus financés et plus de 70 corps de métiers restent interdits aux Palestiniens. Ils ne peuvent exercer le métier de médecin, ingénieur, enseignant, etc. Les Israéliens complotent contre l’UNRWA dont ils voudraient voir la disparition, car cette instance est associée au statut de réfugiés et donc au droit au retour. Le maintien de l’UNRWA est donc plus une question politique qu’une question humanitaire
L’Intifada al-Aqsa va-elle se poursuivre ?
Ihsan Ataya : Tant qu’un Palestinien existera, que ce soit en territoire de 48 ou ailleurs, la résistance se poursuivra car elle est autonome des organisations politiques. La résistance est surtout liée à la conscience de la justesse de la cause. Tant que l’oppression persistera, le Palestinien résistera. Il n’a pas d’autre alternative. Les Israéliens ont peur de chaque Palestinien qu’ils côtoient, au point qu’ils tuent même des jeunes filles. Les sionistes vivent dans la peur parce qu’ils occupent. Les murs qu’ils construisent sont l’illustration de cette peur. Le courage est du côté des Palestiniens, car ils savent qu’ils doivent lutter pour survivre. Dans le processus d’affrontement, il est vrai qu’il y a des acquis et les Israéliens ont déjà perdu (ils ont été vaincus en 2000 et 2006 au Liban et lors des trois guerres de Gaza). A chaque étape, la résistance palestinienne se renforce. Mais la peur de la défaite pourrait conduire les Américains à renforcer leur soutien à Israël. Ainsi, des rumeurs circulent actuellement sur l’installation d’une base américaine dans le désert du Naqab. Même s’il y a eu un démenti, cela signifie qu’ils préparent quelque chose pour éviter la défaite ultime d’Israël.
L’Intifada se poursuivra, qu’elle soit appuyée ou pas par des organisations de lutte armée. Dans tous les cas, elle se poursuivra.
Propos recueillis par T.E.M.