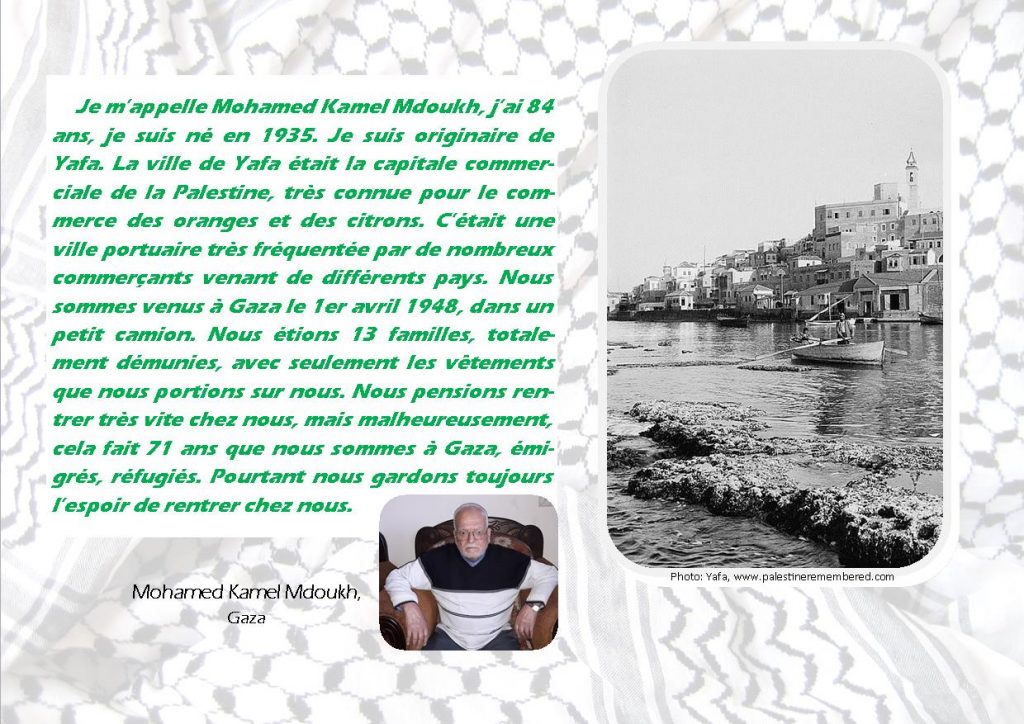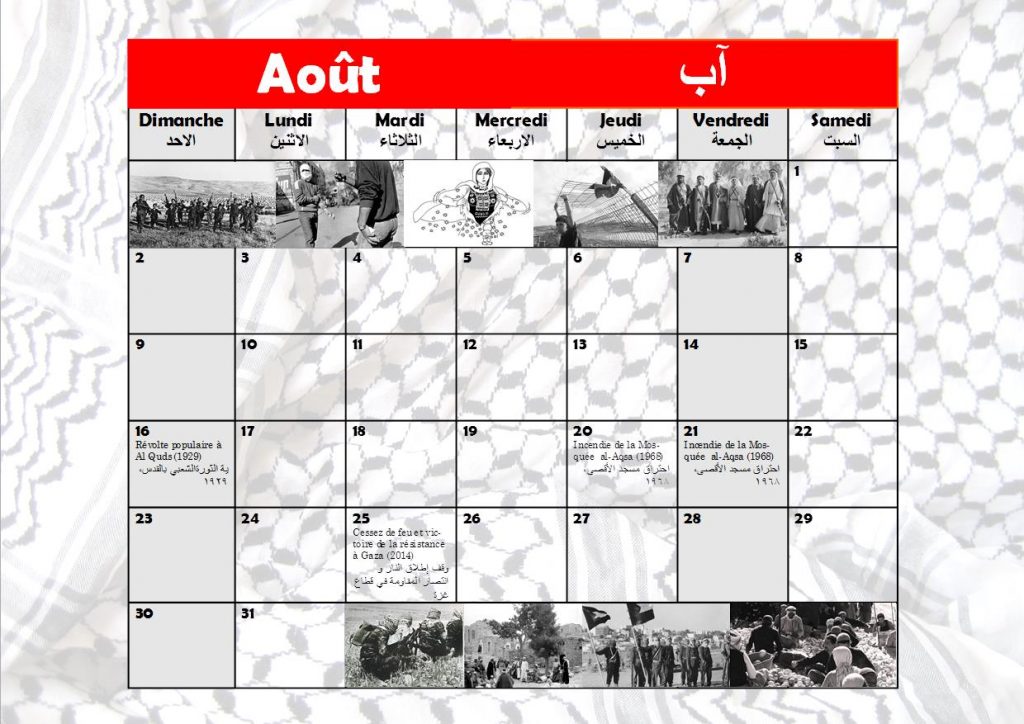Une rencontre avec les jeunes du camp de réfugiés palestiniens de Rashidieh (Liban, septembre 2019)
Comité Action Palestine
Les réfugiés palestiniens représentent aujourd’hui la plus ancienne et la plus importante population de réfugiés dans le monde. Sur une population palestinienne totale estimée à 12,1 millions, seuls 34% demeurent toujours sur leurs terres et dans leur maison en Palestine. On compte un total de 8 millions de réfugiés et déplacés palestiniens. Sur les 5, 5 millions de réfugiés qui bénéficient des services de l’UNRWA, un tiers vit encore dans 58 camps au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Cisjordanie et à Gaza. Dans chaque pays d’accueil, les réfugiés disposent d’un statut particulier, et c’est au Liban que leurs droits fondamentaux sont les plus bafoués depuis 1948. Ils y sont toujours considérés comme des ressortissants étrangers disposant d’un droit de résidence temporaire. Près de 73% d’entre eux (environ 170000) vivent encore dans des camps surpeuplés et misérables, dont les entrées et sorties sont strictement contrôlées. Par ailleurs, depuis 2011, plus d’1,5 millions de Syriens se sont réfugiés au Liban où 1 personne sur 4 est un réfugié.
Alors que les Palestiniens
subissent déjà et depuis toujours des discriminations très sévères en matière
d’emploi (72 métiers interdits), d’éducation, de santé, d’accès à la propriété
et à l’ensemble des services sociaux, le gouvernement libanais, par la voix de
son Ministre du travail Camille Abousleiman, a décidé début juillet 2019 de
durcir leurs conditions d’accès au travail en exigeant l’application stricte de
la loi et l’octroi d’un permis de travail à tous les étrangers, y compris les
Palestiniens. Ces décisions ont alors soulevé une vague de protestations sans
précédent depuis une dizaine d’années et de nombreuses manifestations de
réfugiés ont eu lieu à Beyrouth, à Saida et dans l’ensemble des camps de
réfugiés. Avec la crainte d’un
embrasement des camps, un comité de dialogue a été mis en place entre autorités
libanaise et palestinienne, mais les résultats de ces discussions tardent à
venir. Alors que toutes les organisations palestiniennes se sont montrées unies
pour dénoncer cette nouvelle atteinte à leur dignité, leur appel au calme et
l’absence de solidarité de la part des Libanais ne sont pas faits pour calmer
la colère des réfugiés, notamment des jeunes dont le seul avenir semble être un
nouvel exil.
C’est dans ce contexte, que le
Comité Action Palestine a rencontré en septembre dernier, dans le camp de
Rashidieh, une délégation de jeunes membres de différentes organisations
politiques palestiniennes. Rashidieh est l’un des douze camps de réfugiés
palestiniens au Liban. Il a été établi dès 1948 au sud de la ville de Tyr, à
quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Palestine occupée. Il
compte aujourd’hui 27 000 habitants sur 1 km2. Dans les années
70, avec l’implantation de l’OLP au Liban, il était une base importante de la
résistance. En partie détruit lors de l’invasion israélienne de 1982, le camp
de Rashidieh a aussi beaucoup souffert pendant la guerre des camps. Dans les
années 85-86, le camp a été pilonné à de nombreuses reprises par la milice libanaise
Amal et soumis à un blocus total de plusieurs mois, faisant de nombreux martyrs.
Malgré la famine, les réfugiés ont refusé de quitter le camp. Depuis cette
période, l’unique entrée du camp reste sous le contrôle de l’armée libanaise,
et l’entrée des marchandises et des matériaux de construction est strictement
réglementée.
Les jeunes rencontrés oscillent
entre un profond pessimisme et l’espoir de tous les réfugiés qui est celui de rentrer
chez eux en Palestine. Dans tous leur propos, la colère est palpable.
Pour les jeunes palestiniens au
Liban, l’avenir est complètement incertain. Le sentiment d’insécurité est
grand, car ils n’ont même pas la possibilité de construire un foyer. Ils n’ont
pas non plus la possibilité de faire des études au niveau souhaité et n’ont pas
assez d’argent pour aller à l’Université. D’ailleurs, s’ils ont la chance de
faire des études, ils n’ont aucune possibilité de travailler et le taux de
chômage est très élevé. Quand ils travaillent, ils n’ont pas les mêmes droits
que les Libanais. Ils sont même privés du mérite de leurs succès qui revient
toujours à leur employeur ou à un Libanais. Alors, beaucoup de jeunes pensent à
partir mais aucun ne le fait de bon cœur,
ils n’ont pas d’autre choix.
Les réfugiés palestiniens ont un
grand sentiment d’injustice, car au Liban, contrairement à ce qui se passe dans
les autres pays arabes, ils doivent face au racisme de la plupart des Libanais.
Les Libanais considèrent toujours les camps comme un problème sécuritaire et
non comme une question humaine. Dans la crise actuelle, les médias libanais
sont absents alors que les problèmes sécuritaire et sanitaire dans les camps font
toujours la une des médias. Les camps peuvent être assimilés à une grande prison
et les réfugiés à des détenus. Ils sont interdits aux étrangers, pourtant les
réfugiés sont eux même considérés comme des étrangers.
La décision du Ministre du
travail, membre du parti des forces libanaises (responsables entre autres des
massacres de Sabra et Shatila), traduit une certaine vision politique au Liban,
voire celle du gouvernement tout entier. Les Libanais n’ont pas exprimé de
solidarité envers les Palestiniens, sauf lors de la manifestation à Saida. Mais
aucun homme politique libanais n’est venu dans les camps pour protester avec
les Palestiniens alors qu’ils n’arrêtent pas de s’exprimer sur le sujet. Dix
députés libanais ont présenté une motion de censure, une commission de dialogue
a été créée, mais pour l’instant rien n’a changé. Les Palestiniens se font peu
d’illusions car ces mesures sont sans nul doute le résultat des pressions
exercées sur le Liban dans le cadre du deal du siècle. Le Liban n’a officiellement
pas participé à la conférence au Bahreïn, mais peu après cette conférence, il a
pris des mesures en faveur du deal du siècle. La loi sur le travail existe
depuis longtemps, mais c’est maintenant qu’un ministre ose la faire appliquer sans
préciser les 3 mots les plus importants » à l’exception des
Palestiniens ».
Alors que l’Etat libanais a signé
toutes les conventions relatives aux réfugiés palestiniens, ils les considèrent
comme des étrangers au lieu de les considérer comme des invités en attente de
leur retour en Palestine. Ainsi les réfugiés
palestiniens se voient interdire tout ce qui leur permettrait de résister
dignement. Privés de tous leurs droits,
ils sont soumis à un blocus sévère et des conditions de vie terrible, sous
prétexte d’empêcher une installation définitive. Pourtant les Libanais savent
très bien que les Palestiniens sont opposés à cette installation définitive et
ont comme seul objectif leur Droit au Retour. Malgré tout, l’intérêt des
Palestiniens n’est pas de fuir cet enfer vers un nouvel exil. Les
Palestiniens ne doivent pas être considérés comme des étrangers. Au-delà du
problème du permis de travail, c’est leur statut de réfugiés, celui de leurs
droits civils et d’une vie digne et sure qui sont en question.
Pour la première fois, on assiste
à un mouvement de protestation unitaire parmi les Palestiniens, ce qui est très
positif. Toutes les organisations politiques ont été associées à la commission
de dialogue où tous les droits ont été reformulés. C’est une première depuis
1982 et porteur d’espoir notamment pour la question du droit du travail. Pour
le reste, il faut rester prudent en raison des blocages politiques au Liban et
des pressions extérieures, notamment américaines. Cela n’entame pas la
détermination des jeunes. Dans les camps, tout le monde participe aux
manifestations. Mais certaines organisations font pression pour que la mobilisation
ne sorte pas des camps. Alors les jeunes craignent que le mouvement
s’essouffle, surtout si il reste cloitré et sans couverture médiatique. Ils
peuvent aussi envisager d’autres moyens de protestation tels que le boycott des
marchandises qui entrent dans les camps ou un mouvement de grève de la faim. Ils
ne sont pas autorisés à manifester à l’extérieur ou bien sont privés de parole
lors des rassemblements politiques libanais. Les seules manifestations autorisées à
l’extérieur des camps sont celles destinées à réclamer des visas auprès des
ambassades étrangères dont certaines exigent leur renoncement au statut de
réfugiés en échange.
S’ils ne considèrent pas leur
lutte comme symétrique de celle de leurs frères de Gaza, car ils ne sont pas en
conflit contre les Libanais, ils souhaitent vraiment tout mettre en oeuvre pour
revenir à leur revendication essentielle qui est celle du retour en Palestine. « Marcher
vers la frontière ne doit pas être considérée comme une menace, cela deviendra
une réalité surtout si rien ne change ». Ils sont conscients que tout est fait pour les empêcher de se
concentrer sur leur lutte nationale. Le mode de résistance doit être adapté à
chaque période. Aujourd’hui il semble nécessaire de repenser cette lutte de
manière globale et c’est ce à quoi les Palestiniens doivent s’appliquer et qui
effraye tant leurs adversaires.
Si certains dénoncent l’absence de solidarité internationale, notamment arabe, d’autres voient dans les développements actuels une lueur d’espoir. L’entité sioniste est politiquement faible et les Etats arabes le sont aussi, en atteste l’étendue de leur collaboration avec les sionistes. Mais Gaza est debout et Israël a peur de la résistance. Oui la Palestine sera libérée, il n’y a pas d’autres choix.
Photo: Str/picture-alliance/dpa/AP